Amour, amour, que j'aime tant...
L’amour, cet affect sous injonction - ou comment on tente de transformer le plus indocile des sentiments en devoir.

Dans les librairies, impossible d’y échapper : les tables « féminismes » se multiplient, organisées comme un rayon détaché des sciences sociales. Je déteste tellement toutes formes de catégorisation que j’ai tendance à bouder ces ouvrages, ce qui n’aurait pas été le cas s’ils étaient rassemblés plus simplement en fonction de leurs champs disciplinaires : sociologie, philosophie, anthropologie…
Je sais que ce n’est pas très malin de ma part, mais c’est plus fort que moi.
Mon regard, pourtant, faisait des infidélités à mes principes et revenait toujours à ces piles, au centre desquelles une autrice : bell hooks (l'absence de majuscules est un choix politique et symbolique de l’autrice)
D’un coup, cette autrice encore confidentielle en France il y a quelques années s’est retrouvée omniprésente avec plusieurs titres. De quoi avoir l’impression d’être complètement à la ramasse, d’être passée à côté d’un phénomène. À ma décharge, j’ai découvert que cette intellectuelle, universitaire et militante afro-américaine n’a été traduite en France qu’à partir de 2017, avec un véritable engouement en 2022 lors de la parution en français d’À propos d’amour (All About Love), best-seller aux États-Unis depuis 1999.
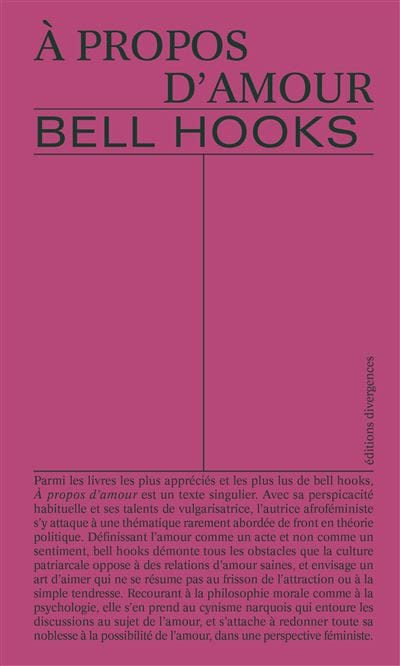
C’est donc celui-là que je me suis acheté, et que j’ai lu.
Je l’ai ouvert pleine d’entrain : enfin, j’en serais aussi ; je rattrapais mon retard de féministe fraîchement éveillée. J’avais même envie de rejoindre la team bell hooks, moi, comme si cette lecture allait me faire basculer une bonne fois pour toute du côté des combattantes contre toutes les formes de domination (ou discrimination) non seulement masculine, mais aussi raciale.
Pourtant, au fil des pages, quelque chose coinçait. Je comprenais la démarche et l’élan, vertueux au fond : transformer les mentalités, encourager à l’amour. Mais j’avais la sensation de glisser, peu à peu dans ma lecture, vers un discours performatif de "bien-être spirituel", flirtant parfois avec des injonctions héritées de nos traditions religieuses ou de courants New Age : “aimons-nous les uns les autres”, “transformer la haine en amour”…
Je caricature un peu mais ce n’est pas si loin, d’où ma gêne.
Sur le principe, je suis d’accord avec tout. Mon dernier article (hors Bullshit articles) parlait d'Utopies, donc moi, si on me propose un monde d’"amour", j’adhère immédiatement.
Sauf que la perplexité grandissant, il fallait bien clarifier ce qui me dérangeait. J'ai feuilleté mon petit catalogue intérieur d'agacements et je me rappelais avoir éprouvé ce pic de grrrr dans un texte du recueil Sororité dirigé par Chloé Delaume, où l’une des autrices affirmait qu’il “fallait” faire davantage preuve d’empathie. De là, connexion instantanée avec tous ces ouvrages, articles ou comptes Instagram où le fameux “développement personnel” est largement promu, truffé d’injonctions habilement déguisées en conseils (pleins de bienveillance off course !)
Qu’on ne s’y trompe pas : il ne s’agit pas de snobisme. J’en partage largement les valeurs. Mais c’est la forme qui cloche, parce qu’elle brouille les pistes.
Je m’explique (après des heures de remue méninges quand même, pour bien identifier le problème, et me donner le droit de remettre en cause des textes d'autrices reconnues (elles !) 😉)
Le malentendu, au fond, tient à une confusion de registres. Nous mélangeons ce qui se ressent, ce qui se choisit et ce qui s’organise.
👉 L’amour et l’empathie relèvent des affects - oui, oui, l’empathie aussi, cette faculté intuitive de se mettre à la place d’autrui, de percevoir ce qu’il ressent. Ces affects surgissent, se retirent et fluctuent. On ne les convoque pas à l’appel, pas plus qu’on ne les évalue. (Sans quoi c’est la voie directe vers la culpabilité car on aime rarement comme il faut, souvent trop ou pas assez. Quant à ressentir vraiment pour l’autre - et pas surtout pour soi - c’est encore une autre histoire.)
👉 Les valeurs, elles, s’affirment : bienveillance, honnêteté, justice relationnelle... On peut les dire, les revendiquer, s’y engager.
👉 Et puis il y a les pratiques, qui s'expriment par les actes : des attentions, des temps d’écoute, des soins, des procédures de réparation... Ils sont visibles et quantifiables.
Sauf qu’à vouloir prescrire la première catégorie - « sois empathique », « aime mieux » - on finit par saboter les deux autres : l’affect se crispe sous l’injonction, l’éthique devient posture, les gestes se délitent faute d’attention concrète. Les mots « amour » et « empathie » sont devenus, trop souvent, des mots-parapluies. Ils donnent bonne conscience et déplacent la charge sur les individus, produisant alors un théâtre moral où chacun est sommé d’éprouver juste.
Exemples en vrac d’usages abusifs de demandes ou de déclarations d’amour qui créent de belles confusions émotionnelles en grandissant...
☛ Il y a des familles où l’on demande d’aimer sur commande : les frères et sœurs, l’oncle qui shlingue, la tante qui pique, et bien sûr le fameux “Tu l’aimes, hein, ta maman ? ton papa ?”, posé précisément au moment où, bah non, on ne peut justement plus les blairer.
Les pauvres gosses se retrouvent alors sommés d’éprouver à la demande, avec une menace implicite : s’ils n’y arrivent pas, c’est l’amour du questionneur qu’ils risquent de perdre.
Ils n’aimeront pas davantage pour autant ; ils apprendront plutôt que l’amour est une chose qu’on feint, qu’on performe pour être tranquille, voire qu’il s’accompagne d’un léger goût de culpabilité.
Un jeu de dupes donc, où les émotions s'imposent davantage comme des devoirs (pauvres choux… comme si l’école ne leur en imposait pas déjà assez !).
☛ Et puis, ils grandissent. Premier concert. Cette fois, ils aiment pour de vrai : un.e artiste, une idole pour laquelle ils ont cassé leur tirelire. Quand celui ou celle-ci balance à la foule un grand “JE VOUS AIME !”, c’est sûr, c’est à eux qu’il ou elle s’adresse !
Eh bien non, mes petit·es chéri·es : votre idole cafouille un peu dans le registre émotionnel. Elle aime, certes, mais pas vous. Ce qu'elle aime, c’est l’amour très narcissisant que vous lui renvoyez.
Ça, oui, elle kiffe. Mais pas sûr qu’elle soit prête à réellement vous consacrer beaucoup de temps 😉
Clarifier le langage n’est pas une manie universitaire (d’autant que je n’en suis pas une), c’est une rigueur nécessaire. Ainsi, si nous réservons « amour » et « empathie » - et d’autres éprouvés comme le désir ou la compassion - au domaine des affects, alors on cesse de les brandir comme des normes. On arrête aussi de nourrir une société de performance émotionnelle où l’on tente de produire de l’affect à force d’énoncés.
Et puisque ressentir ne se décrète pas, il n’est plus question de feindre pour la galerie. On peut enfin parler de façon nette et utile : ici, nous prônons telles ou telles valeurs ET nous souhaitons qu’elles s’incarnent de telles ou telles manières. C’est prosaïque, presque administratif, et c’est exactement là que l’attention reprend de la valeur : dans ce qui se voit, se tient, se fait.
Quant aux sentiments, ces indociles, laissons-les venir quand ils veulent, comme un surplus.
Je reviens donc à bell hooks avec cette boussole. Une fois les approximations sémantiques repérées - et mes agacements contenus - j’ai pu lire autrement. Au fond, son propos tient en une idée simple : quel que soit l’espace - familial, amoureux, amical, social - l’amour ne circule que si certaines conditions existent vraiment. Du temps qui ne se marchande pas, de l’écoute réelle, une sécurité émotionnelle et symbolique, de la justice, une parole qui circule, le droit à l’erreur et la possibilité de réparer.
Autrement dit, l’exact contraire de ce que promeut notre époque : toutes les formes d'économie relationnelle à savoir les réponses lapidaires dans les correspondances, le ghosting, le pragmatisme, l'utilitarisme, l'efficacité...
L’optimisation de soi déguisée en sincérité, la vitesse érigée en vertu.
Vaste programme, donc. Il faudrait une véritable révolution.
Alors, en attendant… on fait comment ?
Je n’en ai aucune idée. Pour le coup, moi qui ai écrit sur l'utopie, l'évolution du monde - et d'une grande partie de ses occupants - me rend parfois tristement pessimiste et désenchantée.
Mais comme je vous le disais, je crois aux actes et aux gestes.
Et je crois au bienfait de leur multiplication.
A la manière des Situationnistes qui proposaient le geste gratuit, le détournement, la dérive, comme arme de déstabilisation du sens et comme une entreprise révolutionnaire de réappropriation du réel, voici donc une tentative d'idées ci-dessous, plus ou moins sérieuse, pour alléger mon scepticisme et voir si, à force de petits riens, on ne pourrait pas rallumer un tout :
Idées en vrac labellisées SDD
• Souriez (sincèrement) à quelqu’un qui vous agace profondément.
• Complimentez un inconnu sur son usage du trottoir.
• Choisissez une personne et faites-lui un geste gratuit.
• Laissez un message vocal à votre banquier pour lui dire que vous lui pardonnez.
• Dé-Ghostez une personne au choix si vous pratiquez (🤬) le ghosting !
• Envoyez “je t’aime” par erreur dans un groupe WhatsApp.
• Répondez à un mail vieux de plusieurs semaines.
• Laissez une pièce dans une machine à café pour qu'un inconnu se serve.
• Tenez la porte à quelqu’un… même s’il est encore à dix mètres.
• Envoyez une carte postale à quelqu’un qui habite à deux rues.
• Appelez un service client et demandez à votre interlocuteur si il va bien.